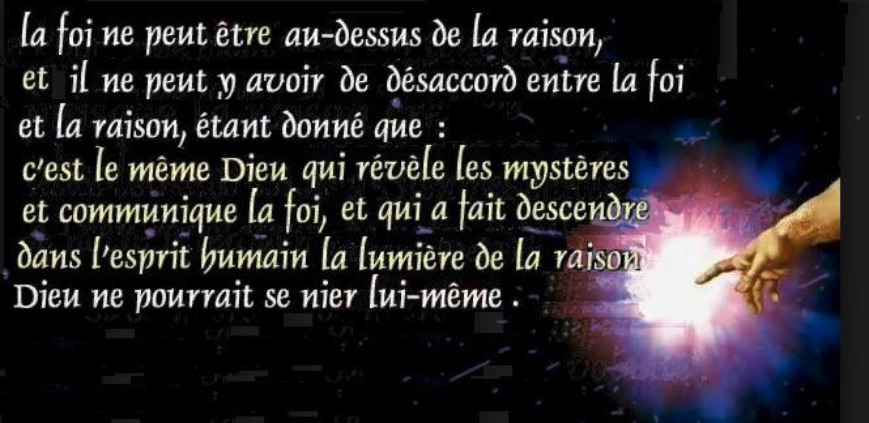
QU’EST-CE QUE LA FOI ?
J'ai eu il y a quelque temps déjà l'occasion de lire une définition dans un journal chrétien (que je ne nommerais pas) et qui m'a semblé bien répondre à ce qu'elle est effectivement pour beaucoup de chrétiens :
« La foi, c'est le fait de croire intensément à une chose tandis que toute notre raison nous induirait, plutôt de ne pas y croire. » Et c'est justement ce que la foi « é-mou-nah » ne doit surtout pas être.
On doit déjà d'une certaine manière considérer que le fait de refuser d'écouter sa propre raison semble être le symptôme d'une certaine déraison. Voir la marque d'une certaine entrave à sa propre liberté de jugement et son libre arbitre.
Donc, la foi vue de cette façon peut paraître une chose bien irrationnelle dans le sens où elle n'a pratiquement pas besoin d'être étayée et se trouve être de façon disons naturel ! À la fois l'antithèse et le complément du doute, et donc à l'opposé de ce que l'hébreu nomme אמונה « é-mou-nah ».
Dans la pensée biblique hébraïque, il y a un seul mot pour dire : la vérité, la fidélité, et la foi.
C'est le verbe hébreu אֲמַן (aman), signifiant la solidité, la fermeté, la constance, la vérité, la véracité, ce dont on peut être certain, la certitude, la certitude objective de la vérité, et qui avec ses diverses formes, comporte plusieurs dérivés. Nous avons le mot hébreu אמן (amèn), qui en dérive et qui signifie : c'est certainement vrai ! Jean l'emploie en le redoublant, amèn, amèn. Et nous avons (é-mou-nah) אמונה qui dérive aussi de la racine : אמן qui est lié à : vérité, amen, fiable, artisan. C'est ce mot hébreu « é-mou-nah » qui a été traduit par les Septante, tantôt par le mot grec pistis, que nous avons à notre tour traduit en langue française par : la foi, - ce qui fausse totalement le sens du mot grec pistis, qui recouvre le mot hébreu « é-mou-nah », puisqu'en hébreu « é-mou-nah » désigne et signifie la certitude objective, le fait de n'avoir aucune raison d'en douter. (donc de la raison) de la vérité, tandis que dans notre français d'aujourd'hui, sous des influences diverses, la foi n'est plus cette certitude et la foi n'est plus un acte de la connaissance, un acte de l'intelligence un acte de raison. Le mot hébreu אמונה « é mou nah » a été aussi dans nombre de cas traduit par le mot grec alètheia qui signifie : la vérité, ou cela est tout à fait naturel. Ce que l'Hébreu appelle « é mou nah », c'est la certitude de la vérité qui est un acte et un assentiment de l'intelligence, et non pas d'avoir la foi en des doctrines ou dans un dogme ou dans un nom, ou une personne aussi éminente soit-elle. Le mot hébreu « é-mou-nah » peut être traduit soit par le mot grec pistis, qui désigne l'acte même de l'assentiment, ou par alètheia, qui désigne ce à quoi l'intelligence accorde son assentiment, l'acte même d'être certain de la vérité de, ou la vérité qui est l'objet de cette certitude.
Croire avec force à une chose que notre raison réfute n'est donc pas « é mou nah » ce n'est pas la foi, et démontre donc bien la grande complexité de la démarche intellectuelle liée à ce principe. Cela voudrait dire que nous préférons croire à des concepts infondés, non vérifiés, et bien sûr invérifiables, plutôt que d'écouter la voix de sa propre raison qui, « elle nous dit et nous incite » à ne pas y croire.
Dans ces conditions, nous devons nous poser la question suivante :
Pourquoi ce comportement apparemment irrationnel face à notre propre raison et à notre libre arbitre ?
On peut peut-être supposer que la réponse est dans le confort intellectuel, moral et psychologique que cette croyance nous procure. En effet, l'exercice de cette foi implique des croyances complexes et multiples ouvrant sur des idées qui découleraient de l'axe principal de l'objet de la foi.
En effet ces croyances et ces idées peuvent nous sembler très rassurantes et très apaisantes par rapport aux doutes, aux peurs, aux angoisses et aux difficultés rencontrés dans ce monde bien réel dans lequel nous vivons tous les jours.
Mais alors dans ces conditions, que peut-on dire de la spontanéité et de la liberté de la foi ?
Les hommes ont-ils des croyances spontanées et les exercent-ils en toute liberté ?
L'homme ne peut se passer de certitudes. Nietzsche montre que même la science se fonde sur une croyance première: la certitude de son efficacité et de son utilité. Cela dit, la certitude, de par son caractère subjectif, est loin de constituer un indice de vérité suffisant. Les défenseurs de la génération spontanée étaient absolument certains d'avoir raison contre Pasteur.
Le rationalisme ou naturalisme pose comme principe fondamental l'autonomie absolue de la raison humaine.
Un discours de Jean Jaurès définit assez bien ce tour d'esprit : « Ce qu'il faut sauvegarder avant tout ; ce qui est le bien inestimable conquis à l'homme à travers tous les préjugés, toutes les souffrances, tous les combats, c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée, c'est-à-dire interdite à la pleine investigation de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus grand dans le monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit, c'est que toute vérité qui ne vient pas de nous est un mensonge, c'est que si l'idéal même de Dieu se faisait visible, si Dieu lui-même se dressait devant les multitudes sous une forme palpable, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de le considérer comme l'égal avec qui l'on discute, non comme le maître à qui l'on obéit » (JAURES, Discours à la chambre des députés, 11 février 1895.)
Au regard des Évangiles Dieu, c'est présenté aux hommes, incarné dans le fils d'un charpentier comme un "simple homme" et comme l'égal à l'homme, pas dans un prince ou un roi. Jésus lui-même se disait "Fils de l'homme" il demande à ses disciples de le suivre et non pas de lui obéir. Même si Jésus a dit en Luc ch 6, 40 :
"Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli sera comme son maître." et Jésus guérit le serviteur du centurion parce que ce centurion est bon je ne dirais pas seulement parce qu'il est bon mais presqu'îl avant tout un "JUSTE". Oui le Maître obtient la pleine attention de Jésus parce qu'il n'est pas seulement un homme bon, c'est un " juste". Et pour Jésus réciproquement, le Maître n'est pas plus grand que son serviteur devant Dieu.
Autrement dit les différents objets de la foi ne seraient-ils pas apportés et induits par d'autres personnes ? Dans l'éducation, par la famille par exemple. La forme le contenu de cet objet n'a-t-il pas déjà été façonné et donnée par des générations d'individus qui l'ont préparée, modelée, embellie, enrichie ? Et cela pour qu'elle raison ?
Donc aller contre sa propre raison et contre son libre arbitre n'est-ce pas déjà les signes d'une certaine aliénation de l'esprit ? L'objet d'une telle foi, à ce point si réglementée ou codifiée, s'appelle une doctrine.
Une doctrine est donc un ensemble de règles établies par des hommes, bien souvent incontournables pour ne pas dire rigides, qui régissent un concept relevant d'une croyance ou d'une idéologie. La doctrine apporte alors les bases ainsi que les limites dans lesquelles doit être exercée ou pratiquée cette croyance. Le développement réglementaire et législatif d'une doctrine aboutit presque toujours à la création d'un dogme "religieux" qui se veut force de loi et qui s'impose comme le seul mode de pensée et comme seule règle de conduite dans la vie religieuse. Ce qui confirme le peu de liberté de choix et de libre arbitre, déjà évoqué, que certains courants religieux laissent à leurs croyants.
Beaucoup de religions découlent de ce principe et se sont instituées en dogmes qui se sont imposés au monde depuis des siècles. Et qui sous ce principe rejette les autres croyances, toute autre pratique religieuse. Le meilleur exemple pour le christianisme est celui de la Trinité de Dieu, "le Père le Fils et le Saint Espris" qui est hérigé un dogme chrétien. Cependant, il existe différentes interprétations théologique du concept de la trinité au sein du christianisme.
Pour Kierkegaard, la foi est une sorte de saut dans l'irrationnel : "Je crois parce que c'est absurde".
Même le grand Pascal ne voyait l'entrée en la religion que par une humiliation de sa propre raison, il disait d'ailleurs sur ce sujet :
« C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. »
Autant dire tout de suite à mon lecteur que bien entendu je ne partage pas du tout, cette pensée du Grand Pascal.
Qu'en a Kant il dit dans sa "Critique de la raison" : « j'ai dû abolir le savoir pour lui substituer la croyance. » Donc la foi de ce point de vue semble s'opposer absolument à la raison. Alors qu'en hébreu et donc pour Jésus, אמונה« é-mou-nah » c'est la vérité la foi qui découle de la raison donc exactement l'inverse. Mais c'est dans le premier état que beaucoup d'entre nous se trouvent aujourd'hui dans nos communautés et même hélas dans tout le christianisme planétaire. Ce qui empêche tous ces chrétiens de progresser et de voir le Royaume du Père autrement dit d'atteindre un état Christique, c'est-à-dire l'éveil spirituel.
Je ne suis pas du tout d'accord bien entendu avec cette définition, et comment est vu et expliqué ce qu'est la foi véritable : « é-mou-nah ».
Psaume 19 1-2 : «....Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. 2 Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à une autre nuit....»
Sans aller cherchez la foi dans les écritures, les incrédules ne perçoivent pas la révélation d'une divinité créatrice dans leur univers qui leur est visible, dans la vie par exemple, et ils en tirent des conclusions erronées, et disent : "Dieu n'existe pas tout cela est le fruit du hasard". Voir, ou ne pas voir dans la nature et dans l'univers, dans la vie un acte de création, œuvre ou un acte de volonté « divine », est donc bien une affaire de raison et non de foi. Chacun à en effet ses propres raisons, forgées par son environnement et son éducation, son niveau intellectuel, etc.. Différentes d'un individu à l'autre.
La science n'empêche pas de croire en Dieu car comme le disait Louis Pasteur : « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène ».
L'être humain a beau percevoir le caractère merveilleux de la nature, de l'univers et de la vie en général, (il suffit de regarder l'audience que font les émissions de télévision sur les sujets tel que celui de la nature, de la vie, et de l'espace pour s'en convaincre) il n'en attribue pas nécessairement la paternité à une divinité. Ce n'est que l'observation au regard de son propre raisonnement des phénomènes de la création qui lui permet d'en déduire ou non l'existence en une divinité créatrice, et dire que c'est « Dieu ». La foi אמונה« é-mou-nah » n'est nécessaire que dans le fait de croire que l'on puisse avoir une connaissance : non pas de son existence, mais de ce qu'il est, et croire qu'une relation intime avec lui est possible. Ce n'est uniquement dans le contexte de cette connaissance et cette relation intime que l'homme fait appelle à la spiritualité. La foi c'est donc croire, ou faire confiance à la spiritualité pour nous mettre en relation intime avec notre créateur... Donc le fait de croire qu'une relation avec Dieu n'est possible que grâce à une religion, à la médiation d'une aide d'un intermédiaire quelle qu'il soit, et même de Jésus lui-même, n'est pas faire acte de foi. Ainsi la foi ce n'est pas croire en Dieu, cela, c'est une affaire de raison, ni en les doctrines d'une religion, mais celle de croire que l'on peut vivre une intimité voir dans l'intimité avec Dieu. C'est ce que dit Jésus quand il dit à ses disciples : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi » qui peut-être comprit comme « gens de peu de confiance » car Jésus sait très bien que ses disciples croient en Dieu, j'oserais dire « dur comme fer », ce qu'il leur dit au sujet de leur foi c'est qu'ils ne vivent pas en grande intimité avec lui, qu'ils n'ont pas confiance, car ils auraient dû savoir qu'ils n'avaient rien à craindre même si leur dernière heure était arrivée.
Donc l'acte de foi ce n'est pas l'acte de croire en Dieu, mais celui de mettre sa cofiance en lui, et pour cela se mettre à la rechercher d'une intimité, d'une relation privilégièrent avec son créateur, pour avoir confiance en lui, et bien sûr pour cela il faut que notre raison croie que Dieu ou quelque chose de transcendant à la création existe. Croire en la création par le simple fait du hasard plus que par un créateur est bien une question de son propre raisonnement, donc de sa raison, la question de la foi est : peut-on mettre toute sa confiance dans le hasard ? Si oui c'est faire acte de foi, si Non il nous faut mettre cette foi dans autre chose. Donc le mot foi est aussi synonyme de confiance.
Cette vision étriquée de la foi de Pascal ou à la Kant ne peut que nous amener à deux situations, ayant le même résultat.
La première c'est le dogmatisme et le fondamentaliste, croire envers et contre sa propre raison et contre tout, placé sa confiance dans une religion et ses doctrines, après avoir "tué sa propre raison", et appeler cela "acte de foi", et donc de ne jamais pouvoir expérimenter la foi véritable l' « é-mou-rath » et renoncer à l'éveil.
L'autre à une situation qui à pour conséquence un rejet de Dieu et des religions et donc de ne jamais expérimenter la confiance en lui ; donc la même conséquence pour deux positions qui se trouvent à l'opposé, l'une de l'autre.
La conséquence c'est l'apparition de gens qui ont vu la stupidité les débordements de tout ceci, de devoir croire sans la raison et ont rejeté, si je peux reprendre une image populaire « le bébé avec l'eau du bain ». Ils sont donc devenus athées ; ils se sont mis à réfuter l'existence de la foi, de mettre leur confiance en ce dieu qui leur demande un tel sacrifice de leur raison, et donc un rejet de Dieu lui-même, avant d'en faire l'expérience et pouvoir mettre en lui leur confiance. En un sens ils sont justes... Mais ils sont dans le faux aussi ! Ils se sont mis dans la négation, d'avoir confiance en Dieu, et ont donc mis cette confiance en autre chose, disont quelque chose de plus matérialiste : l'argent, le travail, la science, que sais-je ! Cette position consiste à réfuter non pas la foi, celle-ci doit toujours être mise dans quelque chose, même qu'en c'est en soit même, mais Dieu en tant qu'expérience.
Dans ce sens, le théiste qui est nécessairement religieux est faux, l'athéisme est faux aussi. La Bible nous enseigne qu'Abraham cru en Dieu, il plaça sa confiance en Dieu, et il n'a eu pour cela besoin d'aucune religion, pas plus du christianisme que du judaïsme qui n'existaient alors. C'est en cela qu'il est le père des croyants, (c'est-à-dire de ceux qui ont une foi véritable) de cette façon de mettre sa confiance en Dieu, et non pas dans une religion. Et je peux affirmer qu'Abraham n'avait aucune religion, ce n'était pas un religieux, il « marchait » si je puis dire selon sa conscience en Dieu. Quand il faisait quelque chose, le plus souvent mais pas tout le temps (ce n'était pas Jésus), c'était selon sa conscience et sa confiance qu'il mettait en Dieu. C'est pour cela que Jésus put dire : « avant qu'Abraham fût je fus » puisque avec son Père il ne faisait qu'un, mais ce n'était pas le cas du patriarche qui était certainement un homme bon et juste mais qui n'était pas parfais, (la Bible nous le dit) il n'était pas un « fils de l'homme » il n'avait pas atteint l'état christique, il était fils d'Adam.
Le disciple de Jésus qui veut pouvoir suivre sur le chemin son Maître, a besoin d'une nouvelle vision, en cela il a besoin de pouvoir se libérer de ces deux prisons. Car pourquoi faudrait-il nécessairement annihiler sa propre raison pour justifier la démarche de la foi ? Nier la raison, c'est encourir aussi le risque de justifier le fanatisme, et le fondamentalisme, qui sont deux fléaux des religions. Et qui est du reste socialement inacceptable et impossible à envisager. L'histoire des religions nous montre le danger de telles dérives. Il n'est donc pas nécessaire de concevoir une opposition aussi radicale entre la raison et la foi. Une personne sensée ne peut accepter de remettre son esprit à l'arbitraire. Il faut bien que l'intelligence ait part à l'acte de la foi et au choix en quoi l'on met sa confiance, cela aux yeux de sa raison. Car la raison et la foi ne doivent pas être incompatibles, si non ce n'est plus la foi mais une aliénation de l'esprit.
Un exemple de foi :
La Bible dit :
« Dieu est Amour » (1 Jean 4, 8 )et aussi : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, (donc l'Amour) de tout ton cœur, de toute ton âme et avec toutes tes forces et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Mt 22, 37-40 et 12, 29-31, qui relie Deutéronome, 6,5 et Lévitique, 19,18.
Ici peu importe ce en quoi l'on croit et notre façon de croire en Dieu, ce qui importe et en quoi nous mettons notre confiance c'est d'aimer son prochain comme soit même, ce qui implique : De tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. C'est cela qui est important !
D.R